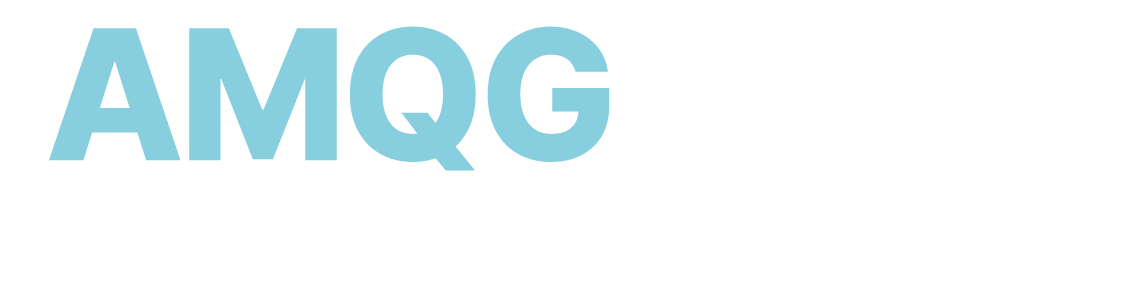AMQG
Votre enfant dit qu’il est du sexe opposé?
Parents d’enfants « trans », inquiets ? Oui, mais lucides! Lucides face aux enjeux politiques, médicaux et économiques de cette médicalisation précoce. Lucides face au besoin impérieux de ralentir, d’écouter, d’accompagner. Et surtout, de remettre la question du sens — et pas uniquement du genre— au cœur de la réflexion.
En Suisse comme ailleurs, la question de l’accompagnement des jeunes en questionnement de genre est devenue un véritable enjeu médical, éthique et sociétal. Une inquiétude croissante émerge autour de la précocité des interventions proposées aux mineurs — souvent sans exploration approfondie des causes sous-jacentes de la dysphorie de genre.
Depuis sa fondation en 2021 par le père et la belle-mère de Lou*, l’AMQG-AUFG a été en contact avec plus d’une centaine de familles à travers la Suisse, ainsi que des familles en France, en Autriche et en Allemagne.
Partout, les parents racontent la soudaineté de l’annonce de l’identité « transgenre » chez un enfant ou un jeune en désarroi – avec un pourcentage élevé de traits autistiques, de troubles psy divers, d’histoires de traumatismes ou d’homosexualité naissante – , et partout, ils reçoivent les mêmes réponses.
INFOX
De plus, les parents découvrent que parfois:
- l’école encourage plus ou moins secrètement les enfants et les jeunes qui le désirent à « transitionner socialement » dans leur dos, et les met parfois en contact avec des associations « pro-transition ».
- ces associations « pro-transition » offrent aux mineurs des conseils sur la « transition médicale », ainsi que des culottes « tuck » de compression de la verge et des testicules pour les garçons, ainsi que des « binders » de compression des seins et des verges en plastique dites « packers » pour les filles, afin de « passer » pour le sexe opposé.
- l’école enseigne parfois aux élèves qu’il est possible de naître dans le mauvais corps, qu’on peut changer de sexe, et crée des angoisses et de peurs chez les jeunes qui se sentent concernés en faisant croire que la société est particulièrement haineuse envers eux.
Des parents souvent culpabilisés et écartés
Dans ce contexte, de nombreux parents expriment leur malaise. Lorsqu’un adolescent ou une adolescente exprime une dysphorie, la pression sociale et médicale à « suivre le mouvement » peut être intense. Remettre en question la transition sociale ou un traitement (hormones, chirurgies) n’est pas considéré comme un acte de responsabilité et de prudence mais qualifié de réaction « transphobe ».
Certains parents décrivent un sentiment d’effacement : leurs doutes, leur connaissance de l’histoire émotionnelle ou familiale de leur enfant sont rarement pris en compte. En particulier, les facteurs de vulnérabilité psychique — troubles anxieux, TDAH, autisme, traumatismes (ex. violences psychologiques et/ou physiques et/ou sexuelles), homophobie intériorisée — sont généralement ignorés dans la précipitation vers une solution médicale.
Explorer la souffrance plutôt que médicaliser l’identité
Comprendre le questionnement de genre chez les jeunes requiert une approche globale, qui inclut :
- Une anamnèse psychologique approfondie ;
- Une écoute des enjeux familiaux, sociaux et scolaires ;
- Une analyse des antécédents psychiatriques ;
- Et un espace thérapeutique non orienté, sans pressions.
Source : Shutterstock
Vous êtes des parents concernés ?
Nous vous recommandons de vous mettre en réseau avec d’autres parents concernés afin de ne pas vous sentir seul(e) face à vos préoccupations. Il est important d’être bien informé, mais une implication excessive peut être éprouvante. Prenez soin de vous, gérez votre énergie avec précaution et ne vous découragez pas. L’essentiel est de maintenir une relation forte avec votre enfant ou adolescent.
Les parents confrontés aux questionnements de genre de leur enfant peuvent contacter l’AMQG pour bénéficier d’un accompagnement.
L’association met à disposition des informations fiables et actualisées sur les questionnements de genre, les cheminements possibles, et les enjeux médicaux, psychologiques et sociaux.
Notre association organise quatre à six rencontres par an à Zurich et 8 à Genève et Lausanne, animées par des parents concernés.
Elles offrent un espace sécurisé et confidentiel pour exprimer leurs préoccupations, partager leurs expériences et poser des questions à des professionnels, à des parents expérimentés ou à des jeunes ayant passé par ces questionnements.
Ces rencontres favorisent le soutien mutuel, permettent de mieux comprendre les besoins de son enfant et d’aborder les décisions médicales et éducatives en toute connaissance de cause, tout en préservant le lien familial et en évitant l’isolement.
Nos adolescents et jeunes adultes se trouvent à différentes étapes de leur parcours de « transition », certains demandent ou ont demandé à changer de prénom (transition sociale), d’autres ont fait une démarche auprès de l’état civil, d’autres encore ont entamé une médicalisation (bloqueurs de puberté, hormones et/ou chirurgies).
Depuis la fondation de l’association, un tiers des enfants des parents membres ont « désisté » ou « détransitioné », c’est-à-dire qu’ils ont évolué vers une réconciliation avec leur sexe.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à eltern@amqg.ch (Zürich) et parents@amqg.ch (Genève et Lausanne). Nous prendrons contact avec vous.
Souhaitez-vous partager votre histoire ? Contactez-nous.
This post is also available in: Deutsch (Allemand)